Décès et fiscalité : Que se passe-t-il avec vos actifs ?
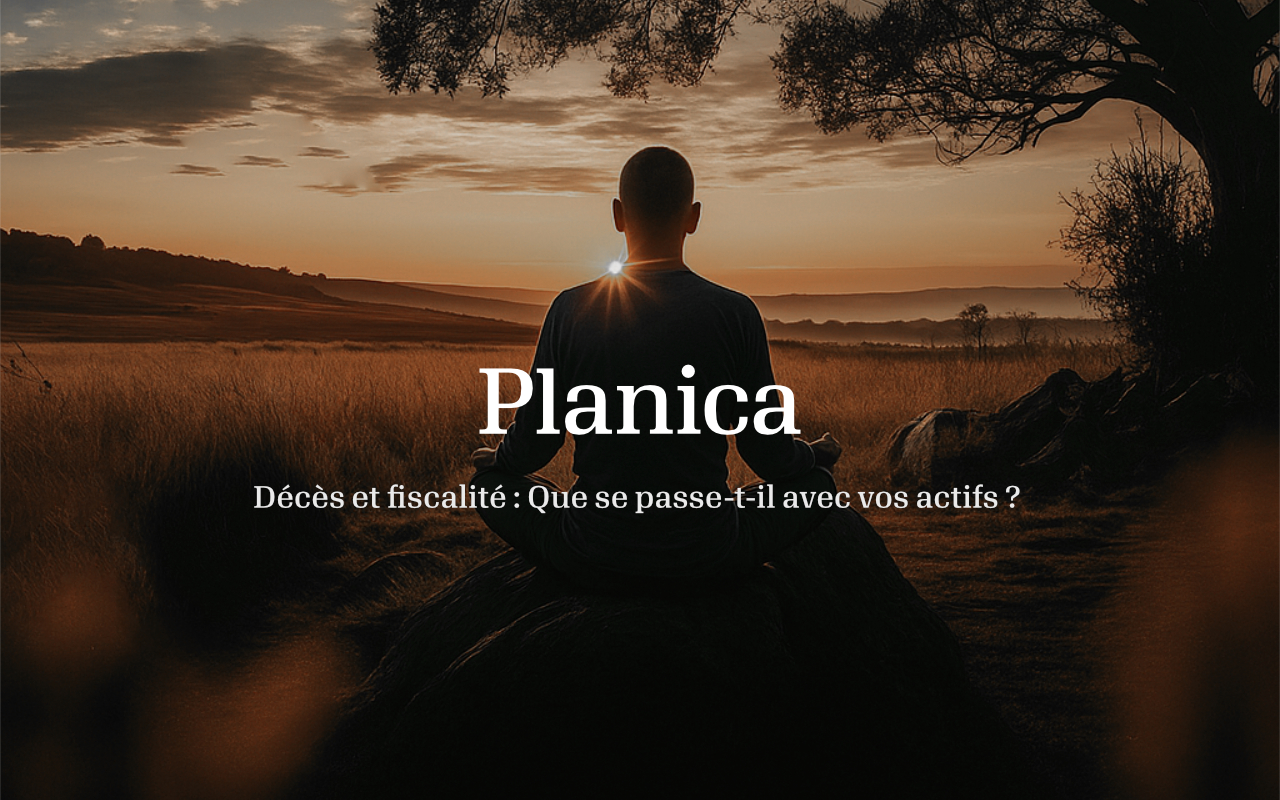
Au décès d’un individu, plusieurs règles fiscales s’enclenchent automatiquement. Ce moment marquant sur le plan personnel peut aussi avoir des effets importants sur le plan financier. Pour les professionnels de la santé ayant accumulé un certain patrimoine, il est nécessaire de comprendre les principales implications fiscales afin de mieux les anticiper.
Disposition réputée
Au Canada, la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) considère qu’au moment du décès, une personne est réputée avoir disposé de tous ses biens à leur juste valeur marchande, juste avant son décès. Autrement dit, les actifs détenus peuvent générer des gains en capital ou d'autres formes d'impôt à payer.
La LIR prévoit toutefois qu’au décès, les biens peuvent être transférés au conjoint sans conséquence fiscale, c’est ce qu’on appelle un « roulement fiscal ». Concrètement, cela signifie que le transfert se fait au même coût que celui payé par le défunt, donc sans gain en capital à déclarer. Ce roulement s’applique automatiquement, mais il est aussi possible de le refuser et de déclencher volontairement un gain, par exemple si le défunt avait des pertes en capital inutilisées.
Quelques exemples concrets
REER
Les sommes détenues dans un REER sont entièrement imposables au moment du décès, sauf s’il est possible d’en faire un roulement au conjoint ou à une personne à charge admissible (Ex: un enfant invalide). Dans le cas contraire, le solde est ajouté au revenu du défunt, ce qui peut facilement faire grimper l’impôt à plus de 50 % de la valeur du REER.
CELI
Le CELI est non imposable au décès. Toutefois, les revenus générés après la date du décès ne sont plus à l’abri de l’impôt, à moins d’un roulement vers un CELI du conjoint.
Immeuble locatif ou terrain
Un immeuble ou un terrain ayant pris de la valeur entraîne un gain en capital imposable au décès, sur la plus-value accumulée. Cela peut surprendre les proches si la succession ne contient pas assez de liquidités pour payer cet impôt. Il est aussi possible qu’il y ait une récupération d’amortissement (pour les immeubles), ce qui engendre un impôt additionnel.
REEE
Il est important de désigner un souscripteur remplaçant dans le testament en cas de décès. Si c’est fait adéquatement, le REEE pourra continuer d’exister sans déclencher d’impôt. Dans le cas contraire, un impôt pourrait être exigé sur les revenus, en plus d’un remboursement des subventions, ce qui peut être très pénalisant.
Société / incorporation
Dans le cas d’une société par actions, telle la société par actions d’un médecin (MD inc.), le décès entraîne un gain en capital sur les actions, ce qui engendre un impôt à payer. La juste valeur marchande des actions d’une société médicale est souvent déterminée en fonction des placements détenus par celle-ci. Il peut donc y avoir un gain en capital important si les actions ont été acquises à faible coût lors de leur émission et qu’elles valent maintenant plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions. Cependant, diverses stratégies fiscales peuvent être mises en place par les fiscalistes pour réduire ce fardeau fiscal. L’assurance vie peut également contribuer à réduire cet impôt.
Une planification qui peut faire la différence
Les conséquences fiscales au décès peuvent gruger une portion importante du patrimoine transmis. Heureusement, certaines stratégies, comme le roulement au conjoint ou à une fiducie admissible, permettent de reporter ou d’atténuer l’impôt. Une bonne planification successorale peut par ailleurs permettre de réduire considérablement l’impôt payable par la succession. À noter que la grande majorité de ces stratégies doivent toutefois être mises en place à l’avance.
Discuter avec un planificateur financier permet non seulement de mieux comprendre les enjeux, mais aussi de prendre les bonnes décisions au bon moment, pour soi, comme pour les siens.
Nicolas Rochette, B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier.
Conseiller en sécurité financière.
Représentant en épargne collective.





